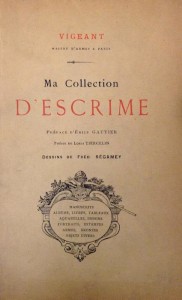Nous citons, pour situer le contexte, la biographie de Simon-Pierre Perret (page 65) :
« Nommé pour la circonstance correspondant du quotidien paternel, Magnard part le 5 décembre 1890 pour Carlsruhe assister à la première exécution de la version intégrale des Troyens de Berlioz. Montée à l’initiative du Théâtre grand-ducal, le chef d’orchestre Félix Mottl, elle est donnée après un an de préparation et de répétitions. Les représentations successives de La Prise de Troie et des Troyens à Carthage occupent les soirées des 6 et 7 décembre. Magnard publie, dans Le Figaro des 6, 8 et 10 décembre, trois longs articles. Il y manifeste toute son admiration et son enthousiasme [ … ] pour la beauté de l’ouvrage et la perfection du spectacle auquel il a eu le bonheur d’assister. »
Le premier article a été écrit avant les représentations, et présente l’événement. Les deux suivants sont des comptes rendus de chacune des deux parties de ces Troyens.
Dans le deuxième article, Magnard commence par un long résumé de l’intrigue de La Prise de Troie, qu’il ne nous a pas paru nécessaire de reproduire ici. Mais vous le trouverez sur le site Berlioz, à la page consacrée à cette création. Quant à l’intrigue des Troyens à Carthage, Magnard lui-même vous renvoie à « votre Virgile ».
Peu après, Magnard consacrera un article au chef d’orchestre, Félix Mottl.
LES « TROYENS » A CARLSRUHE
Il est de toute justice de signaler les services que rend à l’art français M. Mottl, « capellmeister » du théâtre grand-ducal de Carlsruhe. Ce grand artiste, que les Français égarés à Bayreuth ont pu apprécier à sa valeur dans les exécutions magistrales de Tristan et Yseult, est un admirateur de notre école, et il semble avoir pris à tâche de monter les ouvrages dont nous attendons vainement l’exécution à Paris. Cette année, deux opéras français auront été ajoutés au répertoire de son théâtre : la Gwendoline, de M. Chabrier, un drame lyrique, sincère et vigoureux, bien connu aujourd’hui à l’étranger, et les Troyens, de Berlioz, qui vont être joués en entier, pour la première fois, ce soir et demain, 6 et 7 décembre.
Si nous devons cette solennité au goût musical de M. Mottl, n’oublions pas que l’organisation de son théâtre, comme celle de maint théâtre d’Allemagne, se prête singulièrement à l’introduction d’œuvres nouvelles au répertoire. Il n’est peut-être pas inutile d’en dire quelques mots aujourd’hui que la question de l’Opéra prend de l’importance.
Le théâtre de Carlsruhe, propriété du grand-duc de Bade, est dirigé d’après cet axiome : l’art lyrique est un luxe, non un commerce ; il ne rapporte pas d’argent, mais en coûte beaucoup. Le capellmeister n’est pas un entrepreneur, mais un employé. Il ne saurait s’inquiéter du succès possible des œuvres qu’il monte à sa guise : il n’a aucun intérêt pécuniaire dans son théâtre ; ses fonctions sont rétribuées. Aussi, le chiffre des dépenses dépasse-t-il de beaucoup celui des recettes, à la fin de chaque année ; mais la cassette particulière du prince démontre alors son utilité. Rien de plus simple, comme on voit. Avis à notre gouvernement ou à MM. de Rothschild. Le répertoire comprend une quarantaine d’opéras classiques et modernes joués chacun deux ou trois fois l’an. Les répétitions étant aussi nombreuses que le veut le capellmeister, il reste encore du temps pour essayer des œuvres nouvelles.
Ce système ne sera sans doute jamais adopté chez nous ; il est contraire à nos habitudes, aux idées de nos politiciens, aux appétits de la plupart de nos compositeurs en renom. C’est cependant le seul qui permette un répertoire varié.
*
* *
Les répétitions des Troyens durent depuis un an. M. Mottl a respecté le texte primitif de Berlioz : aucun arrangement, aucune coupure. L’œuvre sera seulement exécutée en deux soirées, contrairement aux indications de la partition manuscrite du Conservatoire de Paris. Mais la Prise de Troie et les Troyens à Carthage sont deux drames bien distincts, dont la réunion (les Troyens), entraînerait pour les artistes et l’auditeur une terrible et inutile fatigue. Nous ne pouvons qu’approuver cette scission faite, au reste, par Berlioz lui-même.
Ebauchés vers 1855, les Troyens furent achevés dans les derniers mois de 1858. C’était alors un drame en cinq actes et huit tableaux, d’une durée évaluée par l’auteur à quatre heures et demie. Il faut lire dans ses Mémoires, d’un tour si joliment hargneux, quels encouragements furent prodigués à l’œuvre nouvelle. En voici le résumé.
Berlioz, jugeant que ses rapports avec le monde artistique de Paris ne lui laissaient aucune chance d’être joué, écrit bravement à Napoléon III. Ce potentat, trop soucieux de la destinée de son peuple pour s’occuper de semblables vétilles, garde un silence impérial. Un soir, cependant, aux Tuileries, il accorde au compositeur un court entretien et lui promet de lire son poème, s’il trouve un moment de liberté. Il ne le trouve pas et le manuscrit est envoyé dans les bureaux de la direction des théâtres ; là des hommes compétents déclarent le poème absurde, lui assignent une durée de huit heures et perdent tout sang-froid en songeant au nombre de répétitions nécessaires.
Un an après, le ministre d’Etat annonce gravement à l’auteur qu’on va mettre son œuvre à l’étude. Puis plus rien. C’est alors que Berlioz cède aux instances de M. Carvalho, directeur du Théâtre lyrique (si injustement malmené dans les Mémoires), et, devant l’insuffisance des ressources, renonce à une exécution complète des Troyens. Les trois derniers actes seuls sont montés, et se transforment en un drame en cinq actes : Les Troyens à Carthage. La « première » eut lieu en novembre 1863 et se termina heureusement. Mais la maladresse des machinistes avait fait manquer l’effet de la chasse royale dans la forêt ; et le lendemain cette page si bizarre était supprimée ; suppression qui en entraîna d’autres. Les représentations cessèrent bientôt, Mme Charton, l’artiste chargée du rôle de Didon, n’ayant contracté qu’un court engagement au Théâtre lyrique ; elles rapportèrent néanmoins assez d’argent au compositeur pour qu’il s’offrît le luxe d’abandonner le feuilleton des Débats, son cauchemar.
Restaient les deux premiers actes des Troyens, devenus la Prise de Troie, drame en trois actes. Aucun théâtre français n’y songea et n’y a songé depuis. Il serait puéril de s’en étonner. Aujourd’hui, cependant, le goût du public se modifie, lentement, sûrement, et je suppose que dans une trentaine d’années les œuvres de Gluck, celles de Weber et quelques autres encore seront au répertoire de nos théâtres de musique. Je ne parle pas de Wagner : c’est une question réglée. La République se passe de chimistes mais non de marmitons.
Que Dieu protège Mme de Greffulhe et M. Lamoureux, M. Wilder et M. Verdhurt ! En eux s’est réfugié notre espoir d’entendre quelques-uns des chefs-d’œuvre de la musique dramatique ! Pour le moment, morfondons-nous dans la chambre d’un hôtel badois, en attendant la première exécution de la Prise de Troie.
Albéric Magnard (Le Figaro, 6 décembre 1890)
LES « TROYENS »
Carlsruhe, 7 décembre.
LA PRISE DE TROIE, drame en trois actes
[ résumé de l’intrigue, cf site Berlioz, page consacrée à cette création ]
*
* *
La lecture de la partition d’orchestre ou de piano ne peut donner qu’une faible idée de ce drame ; l’effet au théâtre est immense. Si l’on excepte quelques chœurs vieillots et d’un non-sens scénique absolu, l’intérêt se soutient, poignant d’un bout à l’autre de l’œuvre.
L’apparition d’Hector est une scène inoubliable, et le rôle de Cassandre une des plus belles créations de l’art lyrique.
Mottl a communiqué son enthousiasme à tous les exécutants ; le maître lui eût prodigué ses éloges dont il était si avare.
La voix ample, les nobles attitudes de Mme Reuss font d’elle la Cassandre désirée ; sa création restera dans les annales du théâtre. M. Oberlander a bien l’allure et les accents d’un héros antique, mais son rôle est un peu effacé dans la Prise de Troie, et nous aurons plus d’occasions de l’apprécier dans les Troyens à Carthage.
Le succès a été énorme ; le public allemand s’est dégelé, ce qui ne lui arrive pas souvent, et on a fait une ovation sans fin à Mme Reuss et M. Mottl. À demain le compte rendu des Troyens à Carthage, et un aperçu des splendides décors et de la vivante mise en scène du théâtre grand-ducal.
« Ô ma noble Cassandre, mon héroïque vierge, il faut donc me résigner, je ne t’entendrai jamais ! » Ce cri navrant n’a ému personne ! Berlioz est mort en 1869, et son œuvre, achevée en 1858, est représentée pour la première en 1890, en Allemagne. Cinq Français dans la salle : MM. Bovet, Choudens (à qui nous devons une nouvelle édition, correcte, des Troyens), Colard, Messager et moi.
Que faut-il le plus admirer, le goût musical du grand-duc de Bade ou notre sublime indifférence ?
Albéric Magnard (Le Figaro, 8 décembre 1890)
LES « TROYENS »
LES TROYENS A CARTHAGE, drame en cinq actes.
Carlsruhe, 8 décembre.
Le temps et la place me manquent pour raconter les amours tragiques de Didon et d’Enée ; sauf en quelques scènes épisodiques, le drame suit de très près les premier et quatrième livres de l’Enéide ; que les admirateurs de Berlioz relisent donc leur Virgile. Je parlerai seulement de l’extraordinaire pantomime lyrique du troisième acte : chasse royale dans la forêt. Nous sommes dans une forêt vierge près de Carthage ; à gauche, au second plan, l’entrée d’une grotte, au fond un petit lac entrevu à travers les joncs et les roseaux, et dans lequel se jouent des naïades. Des fanfares retentissent : les naïades s’enfuient. Des chasseurs traversent la scène, alarmés par l’approche d’un orage. Le ciel s’obscurcit, la pluie tombe ; Ascagne et d’autres chasseurs passent. L’orage augmente ; à la lueur des éclairs apparaissent Enée et Didon cherchant un refuge et entrant dans la grotte.
Des faunes, des nymphes, des sylvains surgissent de toutes parts, dansant et hurlant ; ils ramassent les branches d’un arbre que la foudre vient d’enflammer, et s’éloignent dans une ronde folle. Mais les nuages se dissipent ; une douce lumière baigne la forêt, et nous apercevons, dans la grotte, la reine de Carthage pâmée entre les bras du Troyen. Une musique informe, mais vivante, pleine d’idées superbes enserrées dans des rythmes incroyables, rend cette scène une des choses les plus curieuses qu’on puisse voir. C’est confus et génial comme une esquisse de Delacroix.
Citons, trop hâtivement, hélas ! les autres splendeurs musicales de l’œuvre. Au premier acte, l’hymne à Didon, un large choral dans la manière de Hændel, et l’arrivée d’Enée, qu’annonce la marche troyenne, assombrie, navrante. Au second acte, les sonorités exquises du septuor et du duo d’amour, que l’apparition de Mercure rompt si dramatiquement. Au quatrième, la chanson d’Hylas, le duo des deux sentinelles, les lamentations d’Enée. Le cinquième acte en entier est sublime : Berlioz a mis toute son âme dans ces pages qui closent sa vie artistique. Je préfère cependant la Prise de Troie aux Troyens à Carthage ; l’unité en est plus forte ; les banalités y sont plus rares.
Il pleut des sopranos, à Carlsruhe. Après Mme Reuss, Mlle Mailhac, une Didon charmante et passionnée. Je ne puis pardonner à Enée de lui avoir préféré son devoir : cet homme est trop pieux. Pleine de grâce et de tendresse dans les premiers actes, Mlle Mailhac s’est révélée, au dernier, une grande tragédienne, et sa voix chaude me tinte encore dans les oreilles.
Oberlander soutient avec intelligence le rôle ingrat d’Enée ; je lui reprocherai, comme à beaucoup de ténors allemands, d’émettre le son d’une manière rauque, gutturale, déplaisante.
Citons encore M. Plank, un ministre carthaginois d’une obésité majestueuse ; cet artiste de valeur n’a pas craint de se charger d’un rôle peu important.
Les décors des Troyens sont beaux, quelques-uns superbes, comme les remparts d’Ilion et les jardins de Didon au bord de la mer. Les jeux de lumière électrique produisent de curieux effets. L’orage de la chasse royale flamboie avec une variété amusante, et les crépuscules, levers de lune et de soleil éparpillés dans l’œuvre prouvent un souci louable de réalisme. Les apparitions m’ont moins satisfait ; j’ai vu beaucoup mieux un peu partout.
Les costumes sont d’un choix de couleurs bien allemand et, pendant le ballet (dont la dernière danse, le pas des esclaves nubiennes, est un petit chef-d’œuvre), je ne me suis pas lassé de contempler les tailles, les mollets et les tutus badois ; l’élégance de ces objets a un caractère très particulier.
Beaucoup d’éloges à faire, au sujet de la mise en scène.
Les chœurs se remuent, n’éprouvent pas trop le besoin de fixer le chef d’orchestre, vivent enfin ; la chasse royale a été réglée avec une savante confusion. C’est moins l’intelligence, assez lente, des acteurs que leur esprit de discipline qui donnent ces résultats. J’ai assisté à des répétitions. Le capellmeister et, sous ses ordres, le metteur en scène, le chef des chœurs, le régisseur sont rois absolus.
Tous les exécutants, de la première chanteuse au dernier alto, leur obéissent avec promptitude et respect. C’est beau.
Succès aussi complet qu’hier. On a rappelé avec insistance Mlle Mailhac et M. Mottl, dont la fougue toute viennoise ne saurait être trop admirée. Un dernier remerciement à cet artiste d’esprit si éclectique, si impartial.
*
* *
Les Troyens m’apparaissent le chef-d’œuvre de l’art lyrique français en notre siècle. Le drame, traduit des premier, deuxième et quatrième livres de l’Enéide, est rapide, vivant, d’allure shakespearienne ; cette double influence classique et moderne ne constitue pas sa moindre originalité. Le pius Æneas reste d’une médiocrité parfaite, et tout l’intérêt est habilement concentré sur les grandes figures de Cassandre et Didon. L’artiste a pu dédier hardiment son œuvre « divo Virgilio ».
L’influence de Gluck se fait sentir dans les scènes chantées ; les scènes muettes sont d’étonnantes créations. Autant que j’en puis juger par la lecture de la partition française, la prosodie est parfois incorrecte, mais l’accent toujours juste. Les modulations fréquentes et motivées ; l’écriture gauche, maussade comme toujours ; l’orchestre au-dessus de l’éloge. L’inspiration, inégale, témoigne d’un effort continu vers le grand style, et de l’ensemble de l’œuvre se dégage une impression de vérité et de puissance, que seules nous donneraient, avec une intensité plus soutenue, les merveilles de Gluck et de Wagner.
On trouve dans les Troyens quelques rappels de thèmes, et la marche troyenne, dont les transformations nous dépeignent les vicissitudes de la fortune d’Enée, est un véritable leitmotiv. Ce ne sont pas ces petits détails qui m’ont convaincu de la beauté de l’œuvre. Peu importent les systèmes qu’inventent les hommes de génie pour se rendre maîtres de leurs fougueuses inspirations ; ni le récitatif de Gluck ou de Berlioz, ni le leitmotiv de Wagner ne sont des formules définitives : l’art n’en comporte pas. Seule est essentielle l’émotion produite, émotion pure qui délivre ce qu’il y a de désintéressé en nous, nous élève, nous ennoblit ; bien des pages des Troyens me l’ont fait ressentir, la feraient ressentir au public français, et nous voilà loin des fadaises qu’on rabâche dans le mausolée de M. Garnier.
Les musiciens contemporains sont généralement sévères pour Berlioz ; leur tort est de le juger d’après ses œuvres de concert, les seules qu’ils connaissent. Dans ces dernières, en effet, l’imperfection de la technique est souvent fâcheuse. A la scène, les mêmes défauts sont fort atténués, la musique passant au second plan, devenant un accessoire du drame. La beauté de la déclamation fait oublier la pauvreté des dessous ; la dureté des modulations est justifiée par la violence des passions exprimées, et si un développement s’arrête court, un jeu de scène, un changement de décor nous expliquent pourquoi. S’il eût eu des débouchés, Berlioz n’eût sans doute écrit que pour le théâtre, car ses symphonies ne sont, en somme, que des drames lyriques dans lesquels il a remplacé la scène, ou même les acteurs, par un carré de papier imprimé. Il est trop tard pour réparer notre faute ; nous pourrions au moins la reconnaître en jouant Benvenuto Cellini et les Troyens.
Albéric Magnard (Le Figaro, 10 décembre 1890)